Marie-Hélène Lafon
Dans un roman au titre à double lecture, l’auteure en même temps fait retour sur le passé et assume sa pratique de l’écriture comme réinvention
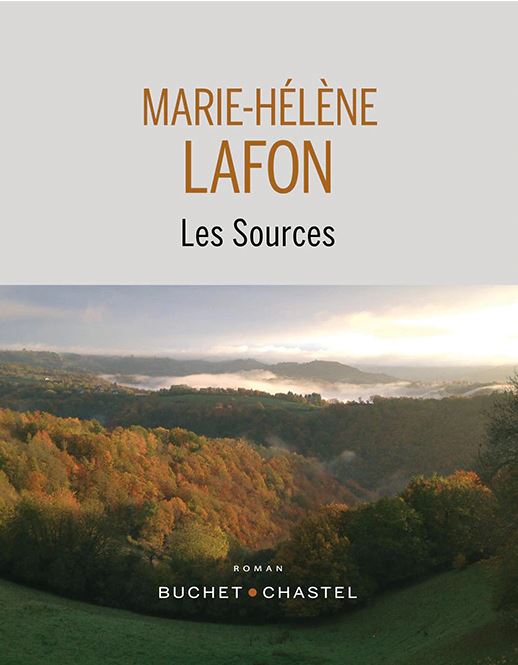
Ce qui frappe d’emblée à la lecture de ce nouveau livre de la romancière de l’enracinement dans le « désert central », c’est son organisation en trois parties de très inégales dimensions, se référant à des dates marquantes d’une histoire familiale qui se déroule sur une période de 54 ans. D’abord le samedi 10 et le dimanche 11 juin 1967, puis le dimanche 19 mai 1974, enfin le jeudi 28 octobre 2021. Leurs évocations successives couvrent 67pages, puis 28 pages, pour littéralement fondre en à peine 4 pages à la fin. Leurs tonalités diffèrent également du tout au tout. Elles ont pour espace unique le Cantal, non pas simple décor pour quelque couleur locale, mais pourvoyeur d’un véritable ADN : sur ses terres au rude climat l’on travaille dur et l’on ne perd pas son temps en vaines paroles, l’on s’y doit en toutes circonstances de « tenir son rang. » Trois fermes, distantes de plusieurs dizaines de kilomètres se présentent comme les véritables pôles, géographiques autant qu’existentiels, de cette histoire d’un demi-siècle. Celles qui avaient vu naître et grandir les personnages centraux, du côté de Saint-Flour, sur des terres situées de chaque côté d’une petite rivière, le Résonnet ; celle plus au nord, isolée de tout dans la vallée sauvage de la Santoire, qu’ils avaient achetée en 1963, après leur mariage quatre ans plus tôt: « une belle ferme, trente-trois hectares, une grande maison, vingt-sept vaches, un tracteur, un vacher, un commis, une bonne, une voiture. » Le jeune couple de paysans s’y était installé avec ses deux petites filles, Isabelle et Claire. Quelques mois plus tard était né un troisième enfant, Gilles.
Cette femme dans sa ferme perdue, au beau milieu du XXème siècle, subit l’antique sujétion imposée à son genre
La mère avait alors vingt-six ans. Le roman s’ouvre quatre ans plus tard, par un incipit qui dans sa sécheresse dit la misère d’une vie conjugale : « Il dort sur le banc. Elle ne bouge pas, son corps est vissé sur la chaise, les filles et Gilles sont dans la cour. » La voix narrative que l’on entendra tout du long ne laisse d’entrée de jeu planer aucun doute. Cette femme dans sa ferme perdue, au beau milieu du XXème siècle, subit l’antique sujétion imposée à son genre. On la découvrira bientôt dans son quotidien, réduite au rôle de bonne à tout faire, maltraitée par son mari, victime de viols conjugaux. La première partie du roman, de loin la plus étoffée, lui est consacrée, à travers le récit de ce l’on n’appelait pas encore un week-end, le samedi 10 et le dimanche 11 juin 1967. Marie-Hélène Lafon dépeint un personnage mutique, qui extérieurement semblerait résigné à sa douloureuse destinée. Mais qui « a trouvé des mots pour se parler à elle. » Usant d’un langage silencieux pour appréhender sa situation et d’une certaine manière résister, quand autour d’elle on la pense résignée. Son texte réussit le tour de force, dans son extrême économie, de saisir simultanément l’impassibilité des dehors et l’effervescence du dedans, la bousculade des pensées et sentiments. Laissant pressentir qu’une rupture déjà se prépare.
Lorsque c’est au tour du père d’occuper le devant du récit, dans une deuxième partie dont il est le personnage central, les choses paraissent se complexifier. Marie-Hélène Lafon effectue maintenant un bond narratif de sept ans. On est au printemps de 1974 et le tyran domestique prend épaisseur humaine, n’apparaît plus tel un bloc de mépris et de violence. Un passé remonte, du temps où il était appelé au Maroc. Une femme avait partagé sa vie, loin des rigueurs et des raideurs du plateau natal. Le père était donc capable d’humanité. L’épouse partie, « il ne la pensait pas capable d’un coup pareil », il n’est désormais plus question d’elle qu’à travers sa seule parole. Depuis le fatidique 11 juin 1967 il dormait seul. Le divorce avait été prononcé trois ans plus tard, « le 17 juin 1970, depuis qu’il a la télévision donc. » La romancière émaille ainsi son texte d’une foule d’annotations et de références à l’actualité qui donnent à son récit sa saisissante épaisseur. De la même façon que la multiplication des dates, qui rendent omniprésent l’écoulement du temps dans cette vallée qu’on pouvait imaginer absente à l’Histoire. On pense ici à la réflexion de Pierre Bergounioux sur l’entrée tardive du « désert central » dans celle-ci. Par diverses manœuvres le père a mis la main sur l’ensemble des biens du couple. Pas question pour lui d’écorner le patrimoine acquis. L’atavisme continue de régenter son existence. A l’opposé de son ex-épouse.
L’alter ego romanesque de Marie-Hélène Lafon
