18/07/2024
Disparition de Benoît Duteurtre
Le souriant polémiste nous quitte prématurément, à l’âge de 64 ans.Je n’oublierai pas qu’il fit ses débuts sous ma houlette, en 1986, au sein d’une équipe de jeunes critiques talentueux dans les colonnes de « Révolution. » Outre Benoît Duteurtre, il y avait là Guillaume Chérel, Stéphane Koechlin, Virginie Gatti, Hervé Delouche, Achmy Halley et Manuel Joseph.
En hommage, quatre de mes chroniques (cliquer sur le lien)
___________________________________________
18/05/2024
Disparition le 18 mai 2024, à l’âge de 92 ans, de Claude Pujade-Renaud. En hommage à cette sensible et subtile autrice, quelques chroniques au fil du temps. Les oeuvres ici citées ont été publiées par les éditions Actes Sud
_________________
« Le Désert de la grâce » (2007)
Les résistants de Port-Royal
Claude Pujade-Renaud sait comme nulle autre s’installer au vif de l’Histoire, toujours en des lieux et des temps où celle-ci entre en résonance avec de grands textes ou de hautes figures du mythe. Ainsi l’Antiquité grecque et latine, les XVIIème et XIXème siècles. Ses récits s’engagent sur les chemins disjoints de la connaissance, reconstituant des itinéraires, ouvrant de nouvelles pistes. Rien d’étonnant qu’elle aborde aujourd’hui l’affaire de Port-Royal, dans un vibrant roman de la dissonance intellectuelle et idéologique. L’on y retrouve son exceptionnelle puissance d’évocation, mais également sa façon particulière de fouiller le passé. En même temps scrupuleusement respectueuse de la réalité historique et porteuse des éclairages de la modernité.
Voici donc ces « Solitaires » murés dans leur discipline et leurs hautaines certitudes, en rupture affichée avec la règle papale et le siècle de Louis XIV. Mais au fond d’eux-mêmes habités de douleurs et de drames, aux prises avec les éternelles histoires humaines. Pour tenir le récit de leur aventure, plusieurs voix ici alternent. Remontant le temps et retraçant l’histoire tourmentée du monastère. En janvier 1712, un médecin de la cour qui chasse en vallée de Chevreuse se trouve être le témoin d’une scène macabre : d’un cimetière près de bâtiments en ruine, on exhume des restes que l’on entasse sur des charrettes pour aller les disperser ailleurs ; des chiens s’arrachent ce qui se déverse pendant le transport. Ainsi s’achève, de l’abjecte manière voulue par le monarque et ses conseillers jésuites, une dissidence commencée un siècle auparavant. Dans les semaines qui avaient précédé, un convoi plus digne avait transféré de Port-Royal à Paris le cercueil de Jean Racine, enterré là depuis douze ans. Pour éradiquer la pensée janséniste, il convenait d’abord d’en effacer les symboles et les dernières traces visibles. Claude Pujade-Renaud recompose cette histoire. Fait se croiser et se répondre des paroles d’hommes et surtout de femmes qui en furent les acteurs, les proches, les adversaires. La fiction vient ici en soutien, tendant ses fils au-dessus d’une multitude de vides. Les creux se remplissent. Les blancs se chargent d’une extraordinaire matière vivante : « Si l’imaginaire ne s’en mêle pas les manuscrits cesseront de nous parler et mourront à leur tour. »
Ces voix, lancées dans un vaste travail de remémoration, évoquent aussi les temps présents, racontent au jour le jour la résistance prenant forme pour la survivance d’une pensée différente. Entre l’expulsion des dernières religieuses, en octobre 1709, et la mort de Louis XIV, en septembre 1715, une intense activité clandestine organise la conservation et la transmission de l’héritage des Solitaires. Deux figures émergent ici, superbement campées par l’auteur : Françoise de Joncoux, la grande animatrice, qui secrètement collige et fait imprimer les textes majeurs du jansénisme, notamment ceux de Pascal, et Marie-Catherine Racine, qui découvre dans l’œuvre de son père des échos et des clefs de son propre roman familial et enfin comprend ce qui, de tout cela, a pu résonner et laisser trace en son corps et son âme. Dans des pages remarquables d’intelligence et de subtilité, Claude Pujade-Renaud manifeste une nouvelle fois ce talent hors pair, par lequel elle parvient à relier les textes à la vie, le dit au non-dit, le conscient à l’inconscient, le langage d’aujourd’hui aux mythes d’hier. Si elle écrit le roman de Port-Royal, lieu de parole et de pensée hétérodoxes face à la mise en scène du pouvoir absolu, elle s’attache plus encore aux personnages auxquels elle prête voix. Ces femmes, vouées à l’alternative de la soumission ou de l’exaltation, qui voulurent signifier leur refus du double enfermement, en se retirant dans ce lieu d’ostensible modestie mais d’authentique richesse de l’échange.
Face au pouvoir temporel se dresse leur exigence intellectuelle et spirituelle. Nouant le présent au passé, jusqu’aux grands récits antiques. Et leur faisant pressentir les choses singulières qui se jouent au fond d’elles-mêmes. Port-Royal, évoqué ici comme rarement auparavant, pourrait alors tenir lieu de métaphore, pour notre époque de spectacle et de nouvel absolutisme.
____________
« Les Femmes du braconnier » (2010)
Les textes ne meurent pas
C’est une composition romanesque particulièrement remarquable, et foisonnante de sens, que nous propose Claude Pujade-Renaud. Ainsi qu’à l’accoutumée, elle ente une fiction sur une histoire vraie dont elle s’attache à dénouer la trame complexe. Faisant parler des silences, débusquant des rapports souterrains, démasquant ce qui voudrait se donner pour insignifiant. Donnant en somme à lire un ordre sous les apparences du chaos. Après s’être installée dans la Grèce antique, l’Espagne de Philippe V ou encore la France du jansénisme, elle s’attache aux destins mêlés de deux écrivains de la seconde moitié du 20ème siècle en Angleterre, Sylvia Plath (1932-1963) et Ted Hughes (1930-1998).
Elle travaille en l’espèce un épais matériau biographique et bibliographique : leurs trajectoires mouvementées s’étaient rejointes en 1956, pour quelques années fusionnelles, dans la vie de couple et dans l’écriture, avant de diverger et d’aboutir au suicide de Sylvia en février 1963. Avec l’art raffiné qu’on lui connaît, elle restitue des lieux, des atmosphères, des paysages. Cambridge où Sylvia rencontre Ted, Londres où ils se marient, le Devon où ils vivent une idylle champêtre avec les deux enfants nés de leur union. Mais aussi la région de Boston, où s’étaient établis les parents de Sylvia, Otto, l’Allemand de Dantzig, et Aurelia, l’Américaine fille de Viennois. Mais encore Paris, l’Espagne, le Canada, la Birmanie. Autour des deux écrivains gravite une superbe constellation de personnages, réels ou fictifs, dont les histoires avaient croisé les leurs. Leurs récits peu à peu complètent et éclairent le monologue intérieur de Sylvia, qui tient lieu de fil rouge.
On entre ainsi dans les profondeurs de l’intimité et dans le vif de la création. On observe la relation ambiguë des œuvres avec la vie : un mélange de total éloignement et d’immédiate proximité. On dépiste les cheminements secrets entre deux écritures, qui en même temps se respectent et se toisent. Impossible de ne pas voir affleurer là une part du vécu personnel de l’auteur, le long cheminement partagé avec le défunt Daniel Zimmermann. Elle donne à tout cela une formidable tangibilité, fait passer la chaleur de la vie, y compris ses tragédies, dans ce qui appartient déjà à l’histoire littéraire. Elle n’a pas son pareil pour façonner un alliage de réel et d’imaginaire. Pour poser des couleurs, faire respirer des senteurs, rendre sensible la présence des corps et des objets dans cette scénographie de haut vol. Ni pour remonter les circuits de l’inconscient et faire entendre en ceux-ci les échos du monde. Elle évoque une première tentative de suicide de Sylvia, en 1953, toujours pas remise du vide laissé par son père, disparu treize ans plus tôt. Pas davantage quitte de ce qu’elle avait cru déduire de son origine allemande. Rien n’est ici affirmé, mais la force de suggestion prend les contours de l’évidence. Une histoire redoublée par la rencontre avec la poétesse Assia Wevill (1927-1969), née Gutmann, qui avait fui l’Allemagne nazie et s’était finalement suicidée comme Sylvia, par le gaz. Qui était aussi devenue la maîtresse de Ted Hughes, avait eu un enfant avec lui. Car rien n’est ici jamais univoque. Dans l’intime viennent à la fois cogner et se répondre le vacarme du monde et les chocs silencieux de la vie. Chacun à sa manière, Sylvia et Ted les saisirent dans leur écriture. Comme aujourd’hui Claude Pujade-Renaud.
_____________
« Tout dort paisiblement sauf l’amour » (2016)
Prélude danois
La romancière arpente les territoires peu fréquentés qui se laissent découvrir dans l’ombre de grandes figures des lettres et de l’histoire. Dans de nombreux livres, elle s’attache en effet aux destinées de personnages souvent ignorés par la postérité, qui ont enrichi de leur présence le regard et la réflexion d’un contemporain illustre. Leur restituant, contre un oubli injuste, la part qui leur revient. Ainsi aujourd’hui Régine Olsen, que Soren Kierkegaard (1813-1855) avait désignée comme son héritière. Qui fut aussi l’unique amour de sa vie. Ils avaient été brièvement fiancés, jusqu’à la rupture soudainement décidée par lui en 1840. La jeune femme éconduite avait dix-huit ans.
En ce début de décembre 1855, suffoquant « dans la chaleur humide et cette exubérance de la végétation » sur Sainte-Croix, dans les Antilles danoises dont son époux Frederik vient d’être nommé gouverneur, elle se souvient : le bateau de Copenhague vient d’apporter le journal avec l’annonce du décès de Kierkegaard le 11 du mois précédent. Claude Pujade-Renaud trace les premiers traits de l’un de ces portraits admirables dont elle a le secret. Pour elle, une manière d’hommage à celle que le penseur, tout près d’écrire ses premiers livres, avait éloignée de cavalière façon. Mais aussi, du même mouvement, une saisissante approche de ce protestant précurseur de l’existentialisme, mais si manifestement inapte au bonheur, peut-être même à la vie. La documentation, précise et approfondie, alimente une narration à plusieurs voix qui fait ressortir la singularité de cette figure complexe, entre l’enfermement dans les convenances de l’époque et la poussée irrésistible de la création et de la réflexion, fondée sur la notion de « reprise ». L’on voit Régine, revenue en 1860 à Copenhague où son mari se trouve plus tard élu maire, s’immerger dans l’œuvre et s’attacher à en démêler les fils cachés. C’est à la confrontation avec un parcours intellectuel et humain, un temps aussi, qu’invite la romancière. Eclairant une destinée et les sources multiples d’une pensée. Le récit s’avance ainsi, sur un demi-siècle, jusqu’à la disparition de Régine en 1904. A Paris s’apprête à surgir une œuvre en résonance avec la « reprise » kierkegaardienne, « incessante, tâtonnante et sinueuse réélaboration dans l’écriture de ce qui fut vécu, et le plus souvent manqué, perdu ». Cette lecture de haute portée donne non seulement à voir et penser : elle appelle à relier.
___________________________________________
14/04/2024
Dissolution de l’Association des amis de Jorge Semprun
Une bien triste nouvelle : Laurent Bonsang, secrétaire de l’Association annonce sa dissolution officielle, faute de bénévoles pour l’animer et malgré sa forte activité (conférences, films…)
Un grand dommage pour la mémoire du grand écrivain espagnol.
04/10/2023
Profondément touché par ces trois pages de « Comédie d’automne. » Merci Jean Rouaud !
___________________________________________
07/09/2023
Pourquoi retraduire ? une réflexion de la germaniste Françoise Wuilmart à propose du « Marie Antoinette » de Stefan Zweig, à paraître chez Bouquins dans une nouvelle traduction
___________________________________________
20/06/2023
Le style est-il de droite ?
Réponse à l’enquête du site littéraire « SECOUSSE »
___________________________________________
05/06/2023
Mathieu Belezi, prix du Livre Inter 2023
Un grand prix pour un grand livre
Voir sur ce blog l’article du 5 novembre 2022
___________________________________________
27/05/2023
Une réflexion à la fois éclairante et caustique sur la traduction comme création, par Paul Fournel : Traduire est écrire (Bibliothèque oulipienne, n° 240)
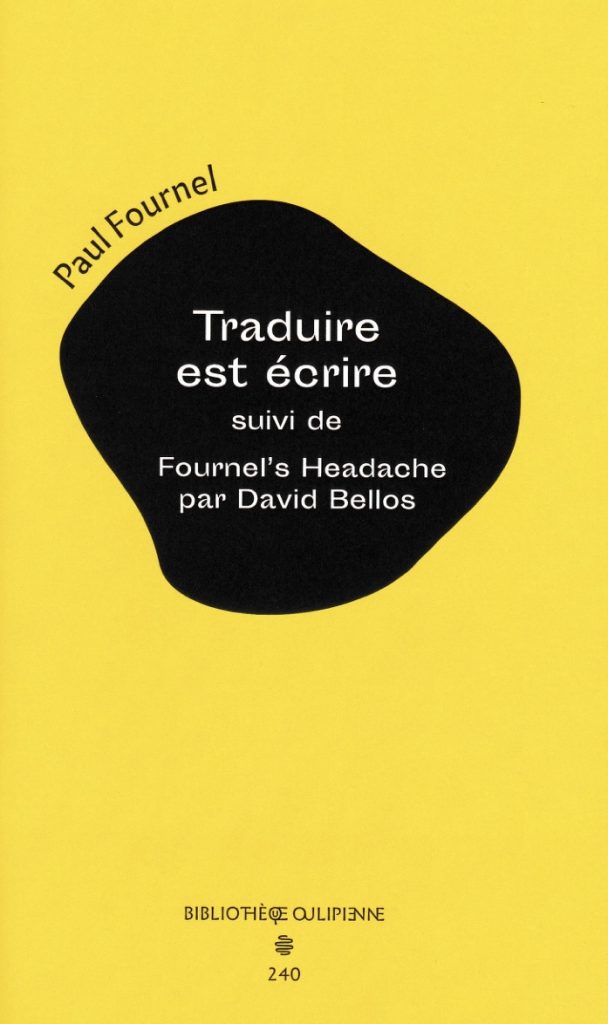
___________________________________________
10/05/2023
« Le troisième sexe« , nouveau billet caustique et imaginatif de Françoise Wuilmart sur le statut du traducteur.
A lire sur le site de L’Association des traducteurs littéraires de France
__________________________________________
30/04/2023
Association des amis de Jorge Semprun
__________________________________________
Quand Jean Rouaud remet le travail dans sa (juste) perspective
__________________________________________
Quand « l’idéal traductif rejoint l’idéal poétique » :
Le nouveau billet de Françoise Wuilmart sur le site de l’Association des Traducteurs Littéraires de France
___________________________________________
Association des amis de Jorge Semprun
Une rencontre à ne pas manquer

___________________________________________
2022 – 2023
Territoires romanesques 2022, créé le 30 juin dernier, compte chaque jour un nombre croissant de visiteurs. Qu’ils soient remerciés de leur attention et, pour nombre d’entre eux, de leur fidélité à un travail critique contraint de quitter le support papier d’un quotidien pour la Toile.
Ce blog se transforme aujourd’hui en Territoires romanesques 2023, pour vous faire partager de nouvelles découvertes et de nouveaux plaisirs de lecture. Dès cette semaine, le premier roman de Pauline Peyrade. Puis Christine Jordis, Marie-Hélène Lafon, Jean-François Kierzkowski, Philippe Lafitte, Jean-Michel Béquié, Yves Bichet…
A tous, une bonne année 2023 !

___________________________________________
La traduction comme création
Sur le métier de traducteur, un vigoureux article de Françoise Wuilmart*, A lire sur le blog de l’Association des Traducteurs littéraires de France
ATLF : https://atlf.org/actualites/
*Traductrice de Ernst Bloch (« Le Principe espérance« ), Friedrich Christian Dellius, Jean Améry, Stefan Zweig, d’ »Une femme à Berlin« …
Professeur de traduction à l’Institut supérieur de traducteurs et interprètes de Bruxelles (ISTI.
Fondatrice et directrice du Centre européen de traduction littéraire (CETL) de Bruxelles.
Fondatrice et directrice du Collège européen des traducteurs littéraires de Seneffe (CTLS)
___________________________________________
ANNIE ERNAUX
PRIX NOBEL 2022
Le stade ultime de la reconnaissance
Dès 1990, dans « Nouveaux Territoires Romanesques » (Editions Sociales), nous faisions paraître, avec Claude Prévost, la première étude sur le travail et l’écriture d’Annie Ernaux.
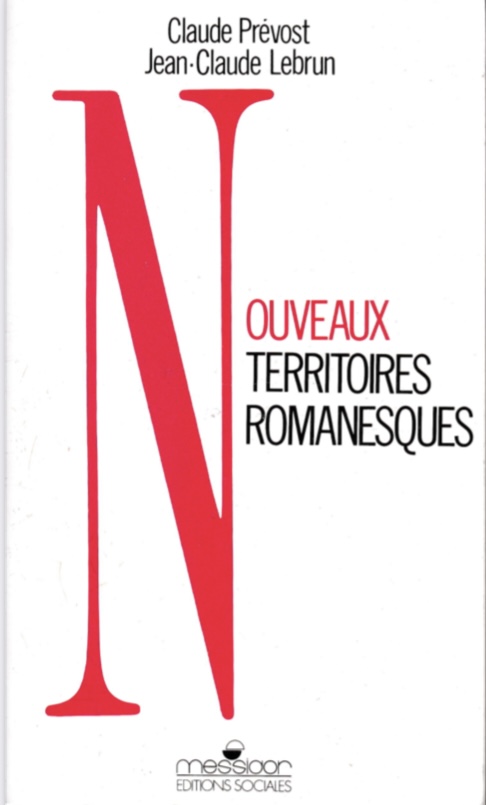
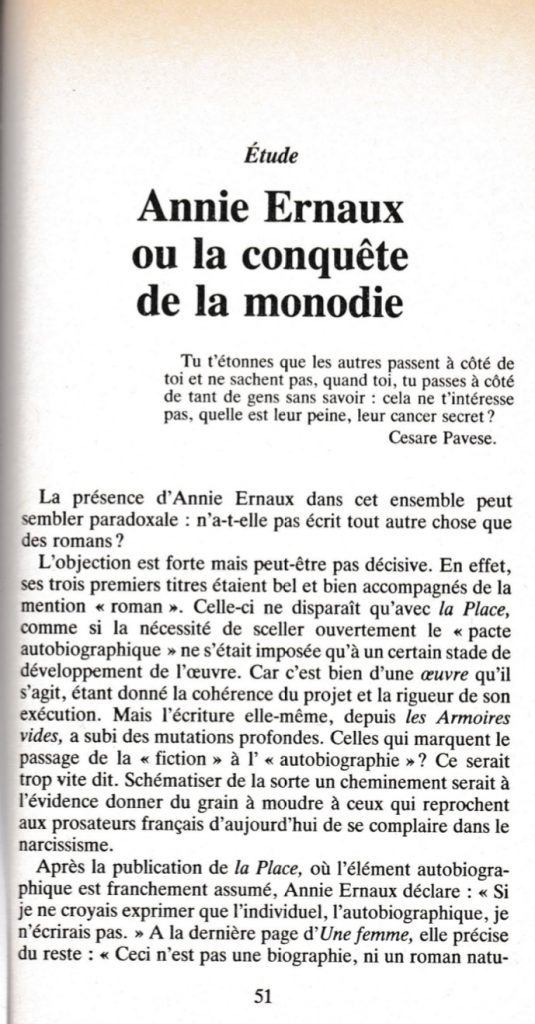
Notre conclusion :
« La prose « a-romanesque » d’Annie Ernaux ne tourne pas le dos à une fonction essentielle du roman, c’est-à-dire élaborer cette alchimie du social et de l’individuel qui donne à chaque destinée son caractère à la fois multiple et irréductible et qui opère, osons le mot, la réconciliation du singulier et de l’universel, acquis toujours provisoire, instable et fragile équilibre »
(« Nouveaux Territoires Romanesques », page 66)
Finalement pas si loin des motivations du jury Nobel
___________________________________________
Ma chronique littéraire du 31 janvier 2008, sur « Les Années »
Une histoire simple
