Le 8 février dernier « Territoires romanesques » consacrait une chronique à « Un Parfum de braises », le précédent roman de Xavier Hanotte. « Le feu des Lucioles », paru début avril, se présente telle une façon de quintessence de la méthode de l’écrivain bruxellois : un fondu-enchaîné de différentes temporalités associé à de constants phénomènes d’écho par-delà les époques. En l’espèce, une fois placés quelques repères, un authentique régal littéraire. Mais pas que…
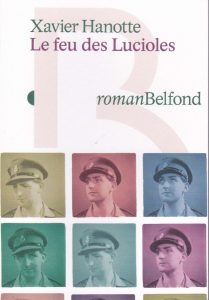
C’est que le « réalisme magique », ce fantastique à la mode belge dont Hanotte se présente aujourd’hui comme l’un des plus talentueux représentants, s’ancre chez celui-ci au plus profond de l’Histoire. Pour rappel, il est le traducteur en français du poète anglais Wilfred Owen mort à 24 ans sur la rive droite du canal de la Sambre à l’Oise le 4 novembre 1918, dont l’œuvre restitue l’enfer des tranchées (« Quel glas sonne pour ceux qui meurent comme du bétail ? »). « Le feu des Lucioles » apporte une nouvelle illustration de cet enracinement de l’écriture, puisqu’en son centre se tient aujourd’hui un autre poète anglais figurant dans l’horizon littéraire de Xavier Hanotte : Keith Douglas, mort également en France à 24 ans, dans l’autre Guerre mondiale, le 9 juin 1944 du côté de Bayeux, dans les premiers jours de la bataille de Normandie. C’est dire combien cette littérature, même relevée d’une pointe d’humour, ne relève pas de quelque évanescence, mais se frotte à la tragique rudesse du monde et ne cesse de mettre la mémoire en jeu.
Impossible de ne pas deviner là-derrière Hanotte lui-même revendiquant sa méthode d’écriture
Dans « Le feu des Lucioles » cela passe par l’entremise d’un certain Frédéric Dutrieux, comme par hasard âgé lui aussi de 24 ans, diplômé en philologie germanique (en Belgique allemand, anglais et néerlandais), qui vient de soutenir un mémoire universitaire plutôt singulier sur…Keith Douglas. Il s’explique sur la philosophie de ce travail qui a quelque peu perturbé le jury: « La biographie de Keith Douglas ne comporte pas tant de trous. J’ai simplement eu envie de les combler à ma façon (…) La fiction apporte du liant et met les faits en perspective, rien de plus. » Impossible de ne pas deviner là-derrière Hanotte lui-même revendiquant sa méthode d’écriture. Cela commence dans les années 1980. Frédéric Dutrieux vient d’être appelé sous les drapeaux, en ce temps de service militaire encore obligatoire en Belgique. Le ton est alors plus proche de Courteline que, par exemple, d’Hubert Lampo ou d’André Delvaux, figures de proue du réalisme magique. Et cependant, par une saute d’écriture à peine perceptible, le lecteur, sans apparemment s’éloigner de Frédéric Dutrieux, se retrouve à la fin août 1944 du côté de Deauville : un sergent portant en effet ce nom meurt dans les combats du débarquement. Celui-ci n’est autre que le grand-oncle du conscrit qui vient d’être incorporé du côté d’Anvers… Par un subtil jeu d’échos et de miroirs rendant caduques les barrières du temps le réalisme magique fonctionne ici à plein, pour le plus grand plaisir du lecteur. Les Dutrieux grand-oncle et petit-neveu, Wilfred Owen et son « lointain successeur littéraire » Keith Douglas entrent dans une manière de construction d’apparence complexe, mais au fond terriblement simple, dont le lieu géométrique unique se trouve être la mort en temps de guerre. Un tour de force narratif qui fait de ce roman l’un des plus emballants, et sans doute des plus incitatifs à la réflexion, de ce printemps.
Un texte superbe et bouleversant qui donne son éclairage de fond au roman
