Cela fait trente-cinq ans, depuis « La table des singes » (Gallimard, 1989), qu’Yves Ravey nous adresse ses fictions comme autant d’informations sur un certain état du monde. Des textes lapidaires, travaillés avec une minutie de tous les instants, dont les épilogues obéissent à un semblable principe déceptif. Tous habités par des personnages combinards, monomaniaques jusqu’à la caricature, en lesquels se donne clairement à reconnaître une humanité passée du stade de la solidarité à celui de la débrouille sans limite. En quoi Yves Ravey à sa façon accompagne et illustre le grand tournant régressif des dernières décennies
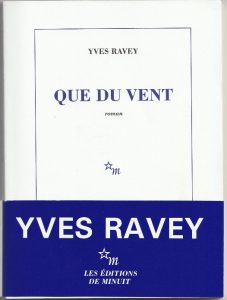
« Que du vent », son tout dernier roman, non seulement ne s’écarte pas de ce champ narratif absolument unique dans l’espace littéraire francophone, mais nous en fournit une saisissante grille de lecture. A commencer par son implantation, un lotissement dans une zone périurbaine aux Etats Unis avec pelouse et piscine, sorte de rêve réalisé de la classe moyenne. Non loin de là coule la Blue Spoon River, qui pourrait bien renvoyer à « Spoon River », classique de la littérature américaine, pour entretenir le dépaysement. Chez Yves Ravey un certain Barnett tient le récit de ce qui arriva à trois couples voisins dans le lotissement, entre réussite en trompe-l’œil et vraie médiocrité. Se dépeignant lui-même comme un « aventurier », le narrateur laisse au lecteur le soin de mesurer ce qu’il entend exactement par là, bien loin de l’acception première du terme, par exemple dans la littérature. Suivant le courant dominant du temps, Barnett faisait des affaires. Ou du moins essayait. Comme patron d’une entreprise d’ambulances qui avait fait faillite, puis créateur d’un entrepôt de produits ménagers à bas prix à son tour menacé de liquidation judiciaire. Il les revendait ensuite « à prix cassés dans certains pays d’Afrique ». Certainement une figure représentative de la vague Uber qui emporte sur son passage l’économie réelle. Certains ont voulu seulement distinguer en lui une incarnation du « loser », occultant tout bonnement la dimension éminemment critique du roman d’Yves Ravey.
Un univers peu à peu se donne à voir, qu’un sociologue qualifierait de postindustriel
Barnett Trapp, en instance de divorce avec Josefa, elle-même partie avec Steven, a pour plus proches voisins Miko et Sally. La nuit on peut voir stationner de grosses cylindrées devant leur maison : Miko possède des laveries, lieu de blanchissage et aussi, en l’espèce, de blanchiment et détournement de fonds. Quant à Sally, la séduisante rousse, elle passe de nombreuses heures, très dévêtue, sur le gazon synthétique au bord de leur piscine, dans le champ de vision et devant la paire de jumelles de Barnett, qui fut troupier dans des sections spéciales en Irak (« Voir sans être vu », principe premier de l’instruction militaire). Le romancier multiplie ainsi les notations qui restituent un contexte et alimentent le parti pris critique. D’autres voisins, Steve et Samantha, se sont pour leur part lancés dans l’élevage de chiens. Un univers peu à peu se donne à voir, qu’un sociologue qualifierait de postindustriel, celui qui offre son terreau aux séries télévisuelles ici caricaturalement présentes dans l’incroyable palette des prénoms. Les romans d’Yves Ravey, c’est en permanence un considérable foisonnement de sens.
L’on peut encore une fois relever le niveau de concertation de cette littérature
