« Jérôme, tout au bord », neuvième roman de Clotilde Escalle, également plasticienne et dramaturge, confirme l’inscription de celle-ci dans ce que l’on pourrait désigner comme l’extrême contemporain. Une pratique de la littérature qui, depuis son premier texte « Un long baiser » en 1993, non seulement se situe délibérément hors des modes, mais choisit d’emprunter des chemins d’écriture plus radicaux, sortes de raccourcis pour plonger au cœur des désordres de l’intime
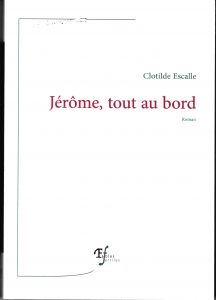
Dès l’entame se dévoile un territoire singulier, celui de Jérôme Veulin, soixante-cinq ans, Parisien retiré dans une campagne pas vraiment paisible ni accueillante. Il y vit seul, « dans son bric-à-brac de pensées.» Après la disparition de sa mère Augustine, apparemment décédée d’une curieuse morsure animale au cou, il a emporté hors de leur maison, pour en faire don à la ressourcerie voisine, tout ce qui ne relevait pas pour lui du strict nécessaire, autrement dit pas grand chose. Il vit dans un dénuement choisi. Quant au monde alentour, il n’est pour lui que désordre, effroi et menace. Avec l’enlisement de l’hiver, les animaux parqués en attente de l’abattoir, le gibier traqué par les chasseurs. La plupart du temps il se terre donc chez lui, écrit ce qui lui passe par la tête, dans un permanent désordre. Comme les remontées de souvenirs de sa trépidante existence d’autrefois ou les moments d’abandon dans les bras de sa mère. Parfois un voisin de passage vient taper au carreau de la fenêtre, manière de vérifier qu’il est toujours de ce monde. Un autre lui donne des œufs pour son unique repas de la journée. Ou bien une marginale à son image vient chercher auprès de lui un peu de chaleur humaine avant de retourner le matin à une autre façon de solitude. C’est que Jérôme, ainsi que l’énonce clairement le titre du roman, vit « tout au bord. » En quelques pages Clotilde Escalle trace le périmètre d’un univers racorni.
Une durée étale, sans hier ni demain, dans laquelle lui-même se voit tel un autre
Quand, à ce qu’on désigne comme la belle saison, Jérôme sort de son antre, c’est pour s’étonner de la vastitude qui l’entoure : « Une immensité se découvre pas moments à ceux qui regardent longtemps », note celle qui tient récit de cette déshérence en une phrase superbement évocatrice. Jérôme est un contemplatif. Dans son champ de vision s’inscrivent indifféremment êtres et objets. La ressourcerie en constitue le lieu de rencontre privilégié. Façon de spectacle dont il serait l’acteur passif, désormais détaché du temps qui passe : « il ne sait rien faire d’autre qu’énumérer ce qu’il voit et tenter d’y croire. » Clotilde Escalle restitue à merveille sa sensation d’être devenu ce spectateur d’une durée étale, sans hier ni demain, dans laquelle lui-même se voit tel un autre. On pense à l’affirmation célèbre de Rimbaud. Des scènes du passé auprès de sa mère cependant ne cessent de l’assaillir en une obsédante omniprésence. Tandis que dans le ciel au-dessus de sa campagne vrombissent les aéronefs de l’armée de l’air : « Et quels sont ces avions de chasse qui sifflent au-dessus de nos têtes… », interrogation racinienne prêtée à celui qui un jour fit des études de lettres et du théâtre. On mesure ici tout ce qui vient à converger dans cet esprit inquiet. Tout ce qu’il ne cesse de noter sur des bouts de papier épars. Ses phrases invariablement s’y terminent pas un « etc », trahissant son renoncement à appréhender la multiplicité de ce qui se présente à lui.
La langue et ses images loin au-delà des usages ordinaires

3 réponses à “Clotilde ESCALLE”
Merci. Je vais lire ce très intéressant récit.
Grand Merci Jean Claude – tes mots sont si précieux 🙏
Merci à toi chère Catherine…