La publication de ce livre constitue un événement éditorial et littéraire. « Quitter Berlin, Journal de jeunesse, 1913-1923 », permet en effet d’avoir accès pour la première fois en français au journal que tint Gershom Scholem de 1913 à 1923, entre sa seizième et sa vingt-sixième année. Le futur grand intellectuel, historien et philosophe spécialiste de la Kabbale, avait ensuite émigré à Jérusalem, où il mourut en 1982. Le Journal conservé dans ses archives a paru dans sa version originale allemande, chez Suhrkamp, en avril 2024. Les Presses de l’Ecole Normale Supérieure donnent aujourd’hui à lire, éclairé par les approches savantes de plusieurs universitaires, ce qui se présente comme un document exceptionnel
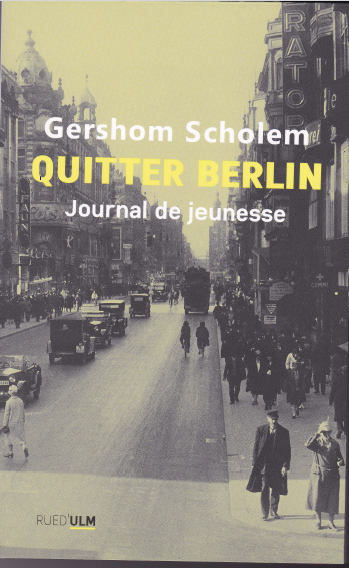
L’on ne saurait trop conseiller aux futurs lecteurs de ce passionnant volume de peut-être aller d’abord directement aux pages initiales du texte de Gershom Scholem, couvrant la période février 1913 – juin 1914, pour prendre une première mesure de l’ancrage de cette pensée. Le jeune juif berlinois ouvre son Journal de très conventionnelle façon par la présentation de sa généalogie : « Je suis issu de juifs de Glogau. Je ne connais pas de rov célèbre parmi mes ancêtres. » Ce qui frappe d’entrée de jeu dans le propos de l’adolescent, avec l’allusion au rov, le rabbin, c’est le souci des racines, de l’inscription dans une tradition en même temps religieuse et savante. On sait de quelle façon lui-même y prendra ensuite sa place. Mais l’on peut également noter un sens certain du réel, non dénué d’ironie, quand quelques lignes plus loin le jeune diariste évoque son grand-père du côté maternel, chef de synagogue : « Il était très grand et aimait les femmes à forte poitrine. » On retrouvera tout du long cette manière de polarité double. Entre la préoccupation spirituelle et ce qu’il faut bien désigner comme une sensibilité matérialiste.
Déjà se profile l’identité du futur grand intellectuel, que l’on peut voir tôt dialoguer avec Walter Benjamin
Dans ce début du Journal Scholem, outre son attention à la mystique juive, montre son intérêt de très jeune homme pour une multiplicité de thèmes. La guerre, à laquelle il va s’opposer. Mais tout autant sa contestation du concept d’assimilation : « Selon Scholem la tragédie des juifs d’Allemagne réside dans le fait qu’ils ont cru dialoguer avec les Allemands, alors qu’« ils se parlaient à eux-mêmes » et que ces illusions, cette fiction […] les ont rendus aveugles aux dangers qui les menaçaient », indique dans une très documentée et éclairante introduction Sonia Goldblum, spécialiste de l’histoire des idées allemandes. Ou encore ses sympathies anarchistes et les désaccords avec l’engagement socialiste de son frère Werner. Sans compter, last but not least, son propre idéal sioniste qui établira une proximité avec Martin Buber. Déjà se profile l’identité du futur grand intellectuel, que l’on peut voir tôt dialoguer avec Walter Benjamin. Y compris avec son côté obsessionnel. Ainsi à la date du 10 novembre 1918, veille de l’Armistice, après avoir dit son admiration pour Karl Liebknecht, la révolution spartakiste a été déclenchée la veille, il s’interroge sur l’ « objet d’une vie révolutionnaire au sens juif ». Et le 13 novembre il reprend la rédaction du Journal pour pointer la différence entre socialisme et anarchisme. Entretemps la Première guerre mondiale a quand même pris fin sur le sol européen. Scholem expédie l’événement dans un bref énoncé en fin de paragraphe, le samedi 9 novembre, « L’armistice devrait être signé après-demain. »
Les années de formation de l’intellectuel sont indissociables de ce qui trame son quotidien et lui donne chair
