« Le Cri du Barbeau » est le troisième roman de Marius Daniel Popescu publié par les éditions Corti, dont Julien Gracq est resté la figure de proue. Citer ici l’auteur, entre autres, des « Carnets du grand chemin » (1992) n’est pas anodin. L’on retrouve en effet chez l’un et l’autre écrivain une semblable alliance de précision du détail et d’usage du grand angle, d’anecdotique et de constante inscription dans l’Histoire. Sans compter, tellement cela va de soi, la belle ductilité d’une écriture portée d’un même élan par un puissant réalisme et un non moins puissant imaginaire. Le titre du livre en fournit l’emblématique exemple
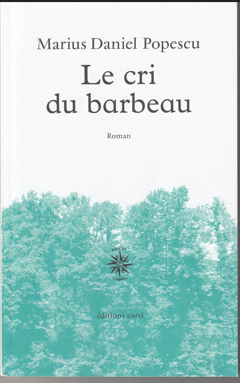
Avant « Le Cri du barbeau », il y avait eu en 2007 « La Symphonie du loup », texte inspiré et superbe honoré par le prix Walser, une référence internationale, puis en 2012 « Les Couleurs de l’hirondelle. » Les trois livres forment ce que Marius Daniel Popescu désigne comme une « trilogie des mots. » Ceux qui « ne devraient pas exister », ceux qui sont partis « en récréation », enfin ceux qui n’appartiennent à personne. La langue française se présente comme le lieu de cette captivante approche pour l’écrivain né en Roumanie avant de venir s’établir en Suisse. Pour lui « le pays de là-bas » et « le pays d’ici. » Le français est conséquemment devenu pour lui autant langue d’écriture que langue d’usage. Il avait quitté le pays du « parti unique (…) quelques mois après l’exécution du couple de dictateurs. » Il y faisait alors des études en sylviculture, il s’était lié d’amitié avec un condisciple de deux ans son aîné. « Le Cri du barbeau » s’ouvre sur la mort de celui-ci, une crise cardiaque, trente-six ans plus tard, dans un bureau du musée roumain où il travaillait. Pour celui qui écrit, désormais installé sur les bords du Léman, cette disparition agit tel un déclencheur. Une façon de recherche du temps perdu se met en branle, dans laquelle se percutent les instants souriants de l’enfance et l’étouffante réalité de la Roumanie socialiste. Tandis que le présent dans la Confédération helvétique ne cesse jamais de s’afficher.
Des pages d’anthologie
Dès les pages d’ouverture, d’une rare densité, l’on voit Marius Daniel Popescu saisir d’un même regard le temps passé et le temps présent. Deux mondes certes aux antipodes l’un de l’autre, mais habités par lui d’une manière qu’on pourrait qualifier de poétique. A commencer par ces pages d’anthologie, dans la septième année de vie du narrateur, le départ avec son père avant l’aube au marché, la première découverte du grouillement animal et humain, d’une vie multicolore alors que le jour se lève, « les fleurs imprimées sur les bas des robes des femmes », les viandes et les légumes entassés, les carpes vivantes dans des tonneaux, le mélange de senteurs, la taverne, les éleveurs de chevaux en attente des saillies, la jument qu’on maquille de boue pour émoustiller l’étalon… Un prodigieux tableau, le narrateur juché sur les épaules paternelles, d’une Roumanie rurale traditionnelle, fait en même temps de tangible matérialité et de puissante suggestivité. Autre temps, autre lieu, le narrateur est maintenant étudiant, pendant l’été il est chargé de l’accueil des touristes dans la cité universitaire vidée de ses occupants. La bureaucratie socialiste s’y déploie dans toute son absurdité, au fil d’une scène moins proche de Kafka que d’une désopilante comédie. Quarante-deux touristes éméchés et très en retard contraints à passer la nuit dans leur car stationné devant le bâtiment : d’autres touristes pourvus également d’une réservation avaient auparavant fait le siège du réceptionniste et obtenu les précieuses clés des chambres. Plus loin dans le livre le narrateur dit tout de sa situation dans le pays de là-bas : « tu vivais le monde du parti unique en dehors du parti unique. »
Marius Daniel Popescu ne cesse ainsi de dispenser ses richesses narratives
