La première édition chez Denoël de « Rue du Havre », le deuxième roman de Paul Guimard (1921- 2004), remonte à 1957. Une nouvelle génération de lecteurs pourra assurément y découvrir, outre un ton irrévérencieux et une liberté de pensée aujourd’hui difficilement concevables, une horlogerie narrative de haute précision, dans le droit fil d’une certaine idée du roman alors contestée
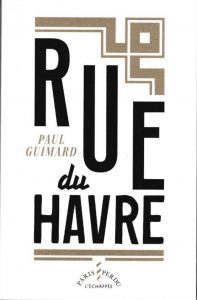
L’écrivain, qui fut sur le tard chargé de mission auprès du président François Mitterrand, fut aussi l’auteur du roman, on dirait maintenant « inspirant », « Les Choses de la vie »(1967), dont Claude Sautet en 1970 tira un grand film mélancolique et tragique. Façon de situer la tonalité de cette œuvre. Il faut donc savoir gré aux éditions L’Echappée et à Blandine de Caunes, fille de Benoîte Groult, l’autrice féministe décédée en 2016 qui fut la seconde compagne du romancier, de nous donner à relire ce texte. Celui-ci en effet restitue très fidèlement l’ambiance grise des années 1950 en même temps qu’il donne à voir une certaine conception du romanesque centrée sur le rôle du hasard. A la même époque d’autres écrivains s’attachaient à déboulonner le statut traditionnel des personnages dans ce qu’ils présentaient, non plus comme « l’écriture d’une aventure », qui fondait jusqu’alors le pacte romanesque, mais comme « l’aventure d’une écriture. » Dans « Rue du Havre », au débouché de la gare Saint-Lazare, c’est autour d’un certain Julien, que les choses tournent. Lointaine allusion à un homonyme de l’autre siècle et figure iconique de l’invention romanesque, même si le Julien de Paul Guimard porte le patronyme programmatique de Legris ? C’est qu’il a survécu aux deux guerres mondiales. Dans sa guérite rue du Havre il vend aux voyageurs, qui ne cessent de se déverser des trains de banlieue, des billets de la Loterie nationale, sous la forme de dixièmes au profit des « Gueules cassées. » En matière de hasard l’on ne peut guère trouver activité plus appropriée. Chaque jour à heures fixes il voit passer les mêmes figures pressées de rejoindre leurs lieux de travail. Parmi celles-ci, descendant invariablement des trains de 8h41 et 8h52, François, la trentaine, employé dans une agence publicitaire (« Julien lui vouait une attention scrupuleuse parce qu’il avait reconnu en lui l’inimitable mélancolie des solitaires »), et Catherine, pas encore vingt ans, étudiante en art dramatique. Sur de tels rails temporels, à onze minutes d’écart, la rencontre dont Julien, la soixantaine et plus d’illusions, s’est pris à rêver pour eux relève de la pure utopie : « Chaque jour, Julien voyait passer devant lui ces deux êtres complémentaires séparés par une éternité de onze minutes dont la dimension tragique le consternait. ». Alors l’agent du hasard, en véritable deus ex machina, va s’activer pour manœuvrer les aiguillages du destin. D’autant que Noël approche. Et avec lui quelques bouleversements dans la vie des trois protagonistes.
Ce roman non seulement se présente en témoignage du temps, mais dans sa construction relève de la mécanique horlogère et de son infinité de rouages minuscules
