Le titre sonne comme une injonction. A l’adresse de soi-même ? A l’adresse du lecteur ? A l’adresse d’une génération guettée par l’oubli historique ? Sans doute aux trois, pourrait-on avancer. Tant celui qui écrit et relate deux mois de détention, en 1970, invite tout un chacun à une réflexion qui de loin excède la circonstance initiale
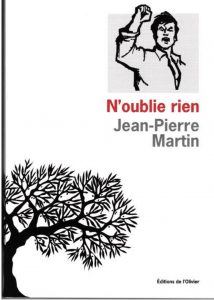
Le 20 mai 1970 un jeune homme de 22 ans est cueilli par la police dans l’hôtel où il se cache. Cela se passe à Saint-Nazaire. Etudiant en philosophie, qui avec 1968 avait pensé venue l’heure de la révolution, il a quitté la fac pour rejoindre le lieu où se joue l’avenir de la société : le monde de l’industrie avec la classe ouvrière comme fer de lance des luttes transformatrices. Jean-Pierre Martin, c’est de lui qu’il s’agit, était un militant de la « Gauche prolétarienne », un mouvement maoïste qui se présentait comme une organisation de « nouveaux partisans » face à la société bourgeoise comme à un parti communiste accusé d’avoir collaboré avec celle-ci et « trahi » sa mission émancipatrice. Ainsi que pas mal d’autres de sa génération il avait donc lâché ses études, au grand dam de ses parents, pour « se jeter dans le monde. » Le plus célèbre de ces jeunes dissidents fut Pierre Overney, tué par un vigile de Renault en février 1972. Le pedigree d’activiste de Jean-Pierre Martin lui avait fermé les portes des Chantiers de l’Atlantique (« tu étais signalé et fiché »). Celui-ci avait ensuite travaillé chez Sud Aviation avant que les Renseignements Généraux n’alertent l’entreprise (« tu es viré au bout de quelques mois »). Mais cela n’avait pas arrêté son activité militante. Il faut dire que l’époque était aux distributions quotidiennes de tracts aux portes des usines, aux collages d’affiches, à la peinture de slogans sur les murs. C’est ainsi qu’il avait distribué un tract justifiant l’attaque au cocktail Molotov de la direction des Chantiers de l’Atlantique. En ce début des années 1970 les accidents du travail s’y étaient en effet multipliés. Pour les autorités le seul délit constitué, c’était ce tract faisant l’apologie d’un « crime d’incendie volontaire. »
Celui qui se qualifie de « prolo d’adoption », ne se retrouve plus alors que face à lui-même
Si le contexte politique apparaît ici essentiel, il ne constitue cependant pas ce qu’on pourrait désigner comme le centre névralgique du récit. Dès son arrestation le jeune militant non seulement avait été incarcéré, mais mis à l’isolement au mitard. Dans la France de Georges Pompidou et de son ministre de l’intérieur Raymond Marcellin on ne relâchait pas la pression sur ce qu’on appellerait aujourd’hui une ultragauche, qui de son côté ne reculait pas devant la violence. Dès son entrée dans les 5m2 d’une cellule infecte, sorte de cul de basse fosse de la seconde moitié du 20ème siècle d’où suintait une « humidité archaïque », Jean-Pierre Martin s’était trouvé confronté à une nouvelle urgence : survivre dans un environnement hostile, face au mutisme réglementaire des gardiens, à la solitude de la courte promenade quotidienne, à l’absence de tout contact, à l’interdiction de toute information, et, last but not least, à la désespérante vision d’un minuscule rectangle de ciel. Celui qui se qualifie de « prolo d’adoption », ne se retrouve plus alors que face à lui-même. La problématique change. Si le politique n’est évidemment pas évacué, il cède la première place à des questions à la fois plus concrètes et plus existentielles. L’hygiène, les repas, les vêtements, la compagnie de l’araignée baptisée Hélène -le détenu a des lettres-, qui tisse sa toile au-dessus de lui (« Ma compagne d’isolement, Ma danseuse immobile, Ma funambule prostrée »), la consolation du chant des mésanges comme chez Rosa Luxembourg emprisonnée à Wronke, la journée rythmée par le passage de gardiens croqués d’un mot à la Daumier (« Bouille écarlate, Poisson froid… »), la « visiteuse » en dame de charité, mais aussi la rupture avec les parents, la timide approche des femmes… Entre journal intime et introspection, le récit des 61 jours de taulard à « Saint Naz » se présente tel un retour sur soi, une sortie des limites, pour ne pas dire des étroitesses, de la communauté militante.
Comme si de chaque côté se produisait un gain d’humanité

2 réponses à “Jean-Pierre Martin”
Merci pour ce récit d une singulière identité – d une intime détermination et rare conviction
Un texte émouvant, sur ces étudiants qui imaginaient apporter la bonne parole au monde ouvrier…